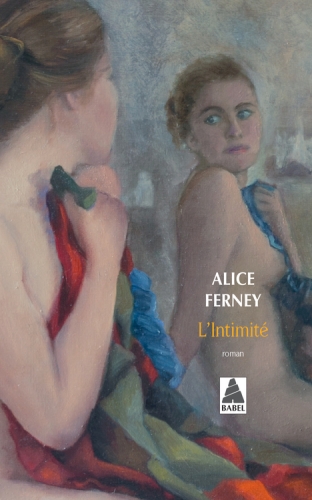D’Isabelle Bary, j’ai beaucoup aimé lire Zebraska et j’ai apprécié qu’on m’offre Le second printemps, son dernier roman, gentiment dédicacé : « Puisse Le second printemps vous emporter sur le chemin d’Adèle et d’Emma. » Leur histoire est dédiée « aux femmes de Kaboul ».

Adèle Carlier, cinquante-deux ans, ressent soudain « une fatigue immense », celle des rôles qu’elle a joués jusqu’alors, « la femme, la mère, l’épouse » : « sur le fil tendu de ma vie, le curseur a laissé plus de place à hier qu’à demain. » Sa vie ressemblait au « perpétuel printemps » d’une femme « forte et courageuse, jolie, bien dans sa peau et dans son temps ».
Libre, mais « sous influence ». Attirée par la littérature, elle avait choisi des études de biologie comme en rêvait son père, puis elle était « tombée dans les bras de Julien » et avait laissé sa vie tourner autour de cet amour. En plus de leurs deux fils, Jules et Sacha, elle « appartenait » à son mari, à ses parents, à ses amis, à son travail en laboratoire. Comme elle tenait un blog sur ses « enthousiasmes littéraires », un directeur de radio, Jean, l’avait contactée : il lui donnait carte blanche pour animer une émission littéraire trois fois par semaine. Elle avait quitté le labo. Elle écrivait aussi, sans arriver pour autant à écrire un roman digne d’être publié.
Adèle se considérait comme une femme libre. Mais le conseil d’administration venait de décider l’arrêt de son émission et lui proposait de gérer un nouveau service culturel de la chaîne. Privée d’antenne, elle se sent désormais appartenir au passé. Dans un entretien à la RTBF, la romancière explique qu’au Japon, la ménopause est appelée « le second printemps ». Adèle : « Je suis alors loin d’imaginer qu’à Paris, au même moment exactement, une jeune femme chavire, elle aussi. Je ne connais pas son nom et j’ignore qu’un jour nos destins seront liés. Je ne sais même pas qu’elle existe. »
C’est ainsi qu’Isabelle Bary introduit le personnage d’Emma, une jeune prof de philo qui vient d’apprendre le suicide d’une de ses élèves après avoir partagé un défi collectif risqué. Révoltée, Emma se décide alors à faire quelque chose à quoi elle pense depuis tout un temps : elle sort d’un tiroir un tissu bleu azur et s’en couvre la tête en le pliant dans les règles, « comme s’il exhalait un goût de liberté. » Le second printemps raconte comment ces deux femmes se révoltent, chacune à leur manière.
Emma, née en Ouganda, adoptée par des parents américains, a grandi à New York puis à Paris. A quinze ans, elle avait été choquée d’apprendre le démantèlement d’un réseau d’escroquerie à l’adoption en Ouganda et s’était rebellée contre son éducation catholique en se jetant dans la lecture du Coran. A trente ans, elle accomplit un rituel secret pour se retrouver. Un personnage surprenant.
Le récit passe de l’une à l’autre : à la première personne pour Adèle, à la troisième pour Emma. Le chemin qu’empruntera la première en prenant des vacances en solo pour la première fois de sa vie lui vaudra plusieurs rencontres importantes, celle de Jeanne, une femme plus âgée, indépendante et sereine, puis celle d’Emma. Le second printemps a pour thème la recherche d’un second souffle, dans une démarche plutôt féministe mais sans rupture avec les hommes pour autant. Ils ont leur place dans leur vie. Comment la vivre plus librement, c’est ce qu’Adèle et Emma cherchent à réaliser à un moment de bascule dans leur existence.
Isabelle Bary brasse dans ce dernier roman des thèmes actuels, avec une grande curiosité pour les autres, abordés sans jugement a priori. Où la recherche d’une nouvelle façon d’être soi va mener ses personnages, c’est ce qui m’a poussée à lire le récit jusqu’au bout. La traversée de la cinquantaine par Adèle est assez banale, j’ai été davantage surprise par sa fascination pour Emma, aux réactions souvent inattendues. Jeanne incarne une autre façon de vieillir.
Il me semble qu’un trop-plein d’explications alourdit le style, plutôt prosaïque. Montrer les situations, les rencontres, les gestes, sans pour autant tous les commenter, laisserait plus de place à l’imagination des lectrices et lecteurs. Fallait-il ajouter un épilogue ? Si vous lisez Le second printemps d’Isabelle Bary, n’hésitez pas à donner votre avis.
 Dans la tiède haleine des fleurs
Dans la tiède haleine des fleurs